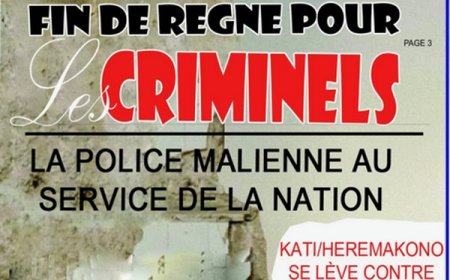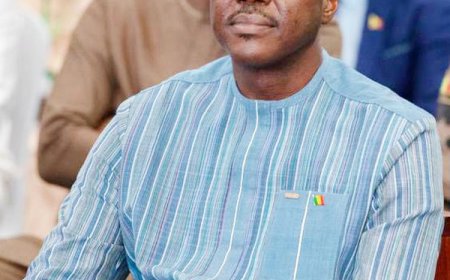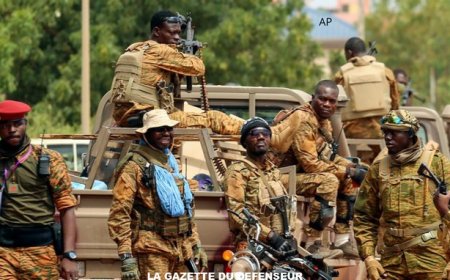Mali / salubrité urbaine : un enjeu vital pour un environnement saint. Une urgence négligée.
Dans de nombreuses villes africaines, la salubrité reste un défi quotidien. Ordures ménagères entassées, eaux usées stagnantes, marchés sans hygiène… Ces images sont familières. Pourtant, elles sont le reflet d’un problème profond, le manque de gestion durable de l’environnement urbain

Quand la propreté devient un combat
À Bamako, comme dans plusieurs capitales du Sahel, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation. Des "journées de salubrité" sont organisées, mais les résultats restent fragiles sans la participation active des citoyens et des commerçants.
"Ce n’est pas seulement l’affaire de l’État", affirme Iba DIAWARA, militant environnemental. "Chacun doit comprendre que la saleté tue. Elle attire les moustiques, propage le choléra et pollue nos nappes phréatiques."
Santé publique et environnement, un lien direct
Le manque de salubrité urbaine est responsable de nombreuses maladies, paludisme, typhoïde, infections respiratoires.
Maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans : En 2019, on estime qu’environ 88 % de la charge des maladies diarrhéiques chez les moins de 5 ans est attribuable à des déficiences en eau, assainissement et hygiène (WASH) .
Impact global du manque d’accès à WASH : Toujours en 2019, des services WASH sûrs auraient permis d’éviter 1,4 million de décès et 74 millions d'années de vie ajustées sur l'incapacité soit 2,5 % de la mortalité et 2,9 % des DALYS mondiaux . Parmi ces décès, plus de 1 million étaient liés aux maladies diarrhéiques, dont 564 000 spécifiquement attribuables à un assainissement non sûr.
Une solution locale, l’exemple du quartier de Kalaban
Dans le quartier de Kalaban Coura, un collectif de jeunes a mis en place un système de collecte communautaire des déchets. Chaque ménage contribue 500 F CFA par mois. Résultat, les rues sont plus propres, les maladies ont diminué et un emploi local a été créé.
"Ce sont de petites initiatives comme celles-ci qui changent tout", témoigne un jeune de quartier.
Que faut-il faire ?
Renforcer la gestion des déchets solides
Installer des poubelles publiques et des points de tri
Éduquer dès l’école sur l’écocitoyenneté
Impliquer les leaders communautaires
Sanctionner les actes d’incivisme environnemental
Conclusion, la salubrité, c’est l’affaire de tous agir pour la propreté, c’est préserver la vie. Ce n’est pas une option, mais une nécessité collective. Car un pays propre, c’est un pays en bonne santé, prêt pour le développement durable.
Mohamed SOGODOGO
Mali / licenciement abusif : quand l'injustice commence à la porte de l'entreprise.
Malgré un cadre juridique protecteur, de nombreux travailleurs maliens continuent d’être licenciés sans motif valable, souvent en dehors de toute procédure légale. Ce qu’on appelle le licenciement abusif reste un phénomène courant, en particulier dans le secteur privé non formel. Enquête sur une pratique qui viole la loi et fragilise les droits des salariés.
Qu'est-ce qu’un licenciement abusif ?
Le Code du travail malien définit un licenciement abusif comme tout renvoi injustifié, sans motif légitime, ou effectué sans respect de la procédure légale.
Selon A. FADIGA, juriste et enseignement au Secondaire à la rive Gauche de Bamako,
Les cas de licenciement abusif les plus fréquents concernent, le renvoi sans motif ou avec un motif flou, le non-respect de l’entretien préalable, l'absence de notification écrite du licenciement, la mise à l’écart déguisée (retrait de poste, suspension illégale…).
Exemples concrets
Fadima, gestionnaire dans une entreprise de Bamako*, a été licenciée après trois ans de service, sans aucun avertissement.
Comme elle, des centaines de salariés chaque année sont poussés vers la sortie sans aucun respect des droits fondamentaux garantis par le Code du travail.
Ce que dit la loi malienne. En cas de licenciement, l’employeur est tenu de,
Notifier les motifs par écrit,
Respecter la procédure disciplinaire (entretien préalable),
Accorder les droits (préavis, indemnités, certificat de travail).
À défaut, le licenciement est réputé abusif. Le salarié peut alors, saisir le tribunal du travail, exiger une réintégration ou une indemnisation.
Les tribunaux peuvent accorder,
des dommages-intérêts (généralement entre 3 et 12 mois de salaire), des arriérés de droits non versés (congés, préavis…).
Les travailleurs vulnérables en première ligne
Les employés domestiques, les ouvriers de chantiers, les travailleurs non déclarés sont les plus exposés. Sans contrat écrit, ni preuve de leur ancienneté, ils ont peu de chances de se défendre.
Si la loi prévoit des recours, l’accès à la justice du travail reste difficile, frais d’avocat, lenteur des procédures, pressions sociales ou économiques.
Certains syndicats comme des juristes et des ONG juridiques comme Avocats Sans Frontières Mali, assistent gratuitement certains travailleurs dans leurs démarches.
Des conséquences humaines
Le licenciement abusif entraîne souvent, une perte de revenu soudaine, des troubles psychologiques,
la rupture sociale, une précarité familiale durable.
En somme, le licenciement abusif est non seulement grave au droit du travail, mais aussi un facteur d’instabilité sociale. Tant que les travailleurs ne seront pas mieux informés de leurs droits, et que les entreprises ne seront pas sanctionnées pour leurs abus, la protection du salarié restera une promesse non tenue.
Un licenciement doit être motivé, écrit et précédé d’un entretien.
Tout renvoi sans respect de ces conditions est abusif.
Le salarié peut saisir la justice et demander réparation.
Mohamed SOGODOGO
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0